Des anecdotes

Dame prenant le chocolat, eau-forte d'après J.-F. de TROY (1679-1752).
- Un illustre consommateur (Alexandre-Jacques Du Coudray)
- Le chocolat du duc de Noailles (Marquis de Valfons)
- Le poids du rituel (François-Antoine Chevrier)
- Un trait d'emportement de Pie VI (Joseph Gorani)
- Frédéric ii de Prusse et le chocolat
- Grâce au chocolat… (Jean-Nicolas Barba)
- Sous l'apparence d'un limonadier…
- La peur du poison (1781)
- Or et chocolat (Geoffroy de Grandmaison)
- « Parler chocolat » (Eugène de Mirecourt)
- L'agent Patou et le porteur de pamphlets (M. Froment)
- Le Chocolat du Castillan (Ana-Gramme Blismon)
-
Le chocolat Mouilleron
- Le chocolat (Comte Bony de La Vergne)
- Le cheval en chocolat (Le Gourmet)
- La manière d'offrir double le prix d'un bienfait (Comtesse Drohojowska)
- La curieuse posologie du docteur Koreff (Musée Universel)
- Souvenir du café Foy… (Arsène Houssaye)
- La macreuse au chocolat (Lemercier de Neuville)
- Les tablettes de M. Gambetta (Jules Claretie)
- Le chocolat au service d'un voleur (Pierre Delcourt)
- Le président Félix Faure à Saint-Pétersbourg en 1897 (Henri Darangon)
- « Les araignées chimériques de l’astronome Lalande » (Fulbert Dumonteil)
- Alimentation en temps de guerre (Francis Jammes)
Un illustre consommateur
« Les Nouvellistes rapportent l'aventure suivante.
M. le Comte de Falckenstein entra dans un brillant Café, de bon matin, & vêtu simplement à son ordinaire : il y demande une tasse de chocolat. Les Garçons ne s'empressant pas de le servir parce qu'il étoit trop matin, il sortit sans mot dire, & alla dans un petit Café ; le Voyageur y demande une tasse de chocolat, le Maître lui répond poliment qu'il va le faire chauffer, s'il veut attendre. Seul dans le Café, il se promene, interroge le Maître du logis, &c. Sur ces entrefaites descend la fille de la maison (assez jolie, dit-on). M. le Comte de Falckenstein la salue, & dit au pere qu'elle est bonne à marier. “ Hélas oui, répartit le Bon-Homme, mais je ne suis pas riche : si j'avois mille écus à lui donner en dot, je la marierois à un joli garçon, mais… ”
Le Chocolat est chaud, on l'apporte, le Voyageur le prend, paye le prix de sa tasse, & demande une plume, du papier & de l'encre. La future épouse, sans le savoir, obéit ; & à l'honneur de servir M. le Comte de Falckenstein, sans le savoir encore. Ce Prince écrit une ordonnance de six mille francs, à prendre sur son Banquier à Paris, pour être employés à marier la fille du Limonadier.
Nous ne garantirons point l'exactitude de cette anecdote, mais elle a beaucoup de rapport au trait de bienfaisance que nous allons rapporter. […] »
Alexandre-Jacques Du Coudray
Anecdotes intéressantes et historiques de l'illustre voyageur, pendant son séjour à Paris. Dédiés à la reine, Seconde édition, Paris, 1777.

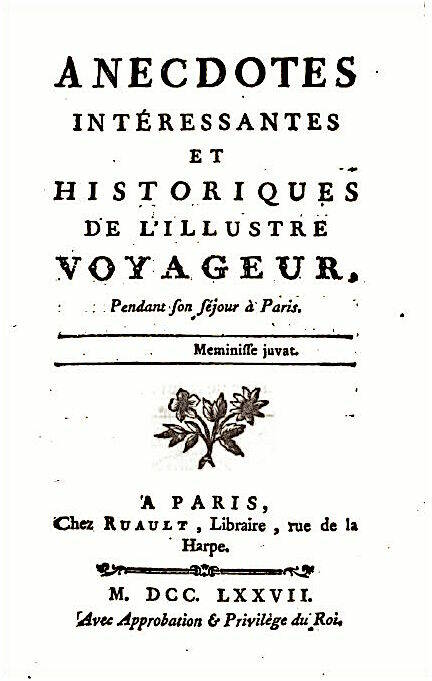
Le chocolat du duc de Noailles
« La nuit était fraîche ; le duc de Noailles, auprès de qui j'étais assis, me prêta une de ses redingotes. J'allai un instant à la queue de la tranchée, où je trouvai un feu entouré d'officiers et de travailleurs ; on me fit place avec des marques de respect qui m'étonnèrent moins, lorsque je m'aperçus que c'était aux insignes de l'ordre du Saint-Esprit placés sur la redingote du duc de Noailles que je devais et ma place et des hommages. Je revins à mon premier poste auprès du duc, qui, une heure avant le jour, céda au sommeil. J'allais en faire autant lorsqu'un garçon d'office me dit : “ Monseigneur, voilà votre chocolat bien moussé et de bonnes rôties. ”
Je bénis l'honnête garçon qui me traitait si bien et si poliment. J'en profitai, je pris le meilleur chocolat, et il partit. Le grand jour venu, M. le duc de Noailles demanda son chocolat, très-étonné du retard ; on va chercher le garçon d'office, qui jure que monseigneur l'a pris et a mangé les rôties du meilleur appétit. J'étais sorti lorsqu'on fut l'appeler, ne me souciant pas d'assister à son interrogatoire. Je quittai la redingote qui avait fait mon honneur, toujours par l'opération du Saint-Esprit. J'allai faire quelques tours dans la tranchée, et ne revins qu'après qu'on eut cherché, mais en vain, à prouver au duc qu'il avait pris son chocolat. »
Souvenirs du marquis de Valfons, vicomte de Sebourg (1710-1786),
publiés par son petit-neveu le marquis de Valfons, Paris, E. Dentu, 1860.

L'épisode se passe en septembre 1733, au siège de Kehl. Maréchal de France, commandant la tranchée, le duc de Noailles nomme le jeune officier major qu'était le marquis de Valfons (ci-dessus) pour porter ses ordres…
Le poids du rituel
« La gravité ministériale est un fardeau qui devient incommode à mesure que vous le portez mal-à- propos. J'ai vu à la cour de Turin un ambassadeur qui ne prenoit jamais son chocolat, que son maître-d'hôtel, qui l'apportoit, ne fût précédé de deux écuyers, & suivi de vingt valets de pied. Ce pénible service étoit à peine fini, que le ministre, reconduisant d'un geste toute cette valetaille, se plaignoit du joug superbe auquel sa dignité l'asservissoit ; grimace dont personne n'étoit la dupe, parce qu'on ne plaint point un homme qui se met lui-même dans les fers. »
François-Antoine Chevrier, Le Colporteur, roman satyrique, Londres, 1762.

Un trait d'emportement de Pie VI
« […] le souverain pontife étoit fort sujet a de très-violens accès de colère […]. Un valet-de-chambre servoit un jour un chocolat au pape ; il en versa une goutte sur l'assiette : le souverain pontife la lui arracha des mains avec !a tasse qui contenoit le chocolat brûlant, et jetta le tout au visage de ce malheurenx, en le faisant chasser à l'instant de son service sans lui donner aucun dédommagment. »
Joseph Gorani
Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des mœurs des principaux États de l'Italie,
Tome 2, Paris, 1793.

Frédéric II de Prusse et le chocolat
« Un des plus glorieux [traits de la personnalité du souverain] est de n'avoir jamais fait périr personne, pas même ceux qui ont attenté à sa vie. Pendant le cours de la derniere guerre, étant en Silésie, son valet-de-chambre de confiance fut gagné pour lui donner du poison ; le roi, qui est physionomiste, s'aperçut un jour que cet homme trembloit en lui donnant son chocolat ; il le regarde fixement & lui dit : Je suis certain que tu es payé pour m'empoisonner. L'homme nia, mais le roi donna le chocolat à un chien qui mourut après deux heures : ce prince se contenta de tirer de cet homme, par qui & comment il avoit été gagné, n'en parla à personne & envoya le valet-dc-chambre à Spandau, d'où il est sorti depuis peu d'années. »
Huitième Recueil philosophique et littéraire de la Société typographique de Bouillon,
Bouillon, 1779.

Portrait par Anton Graf, 1764.
N. B. Selon certains, Frédéric II de Prusse aurait eu l’habitude de consommer son chocolat accompagné de moutarde et de poivre !
Grâce au chocolat…
« Le prince, dans les premiers mois de son mariage, se montra en quelque façon injuste pour une femme qui se faisoit aimer de tout le monde et pour laquelle il n'avoit pu vaincre en lui la répugnance. Ce prince, sans être absolument méchant, étoit d'un caractère fort brusque, quoique facile à conduire ; ce défaut, il le porta à l'extrême à l'égard de sa femme, et, sans savoir ce qui se passoit dans le secret, il fit éclater en public des mouvemens de colère indignes d'un homme de son rang : la princesse ne répondoit ordinairement à ses brusqueries que par des caresses.
Un jour, ce prince emporté donna toute la cour le scandale affreux d'une scène humiliante pour sa femme. Ils étoient tous deux à déjeuner, et le chocolat qu'on leur servoit étoit fort chaud ; la princesse eut l'imprudence de ne point avertir son époux, qui prit sa tasse avec avidité, et qui se brûla. Cette aventure fit faire un éclat de rire à l'épouse du prince, qui, transporté de fureur, jeta sa tasse toute brûlante sur la gorge de sa femme. La liqueur fit une vive impression sur la peau de la princesse, qu'on se hâta de secourir. Les témoins de cette scène furent indignés de cette brutalité ; et lorsque-le roi en fut instruit, il ordonna à son fils de rester en arrêt huit jours dans ses appartemens. La princesse cependant parvint à calmer la colère du roi, et à faire remettre en liberté son époux. Le roi lui sut bon gré de s'intéresser en faveur d'un homme qui lui donnoit de justes sujets de plaintes. Ce procédé généreux de la princesse fit ouvrir les yeux à son époux, qui se repentit de son action, et qui, depuis ce moment, ne lui donna plus que des preuves de sa complaisance. Les remontrances de son père agirent efficacement, et vinrent fort à propos au secours d'une femme qui sembloit être menacée d'un sort malheureux.
Le premier pas étoit fait ; il s'agissoit de vaincre cette répugnance qu'il avoit pour cette princesse ; et les attentions, les soins assidus de sa femme, lui firent prendre la résolution d'être avec elle plus circonspect. De la complaisance il passa bientôt à l'estime, et cette dernière affection le conduisit à l'amitié. Il ne vit plus sa laideur ; il n'envisagea que ses bonnes qualités, et sa femme obtint toute sa confiance, au-delà même qu'on auroit pu l'espérer ; car de tous les hommes il fut le plus trompé. »
Jean-Nicolas Barba (1769-1846)
Vie politique de Marie-Louise de Parme, reine d'Espagne*
* Vie politique de Marie-Louise de Parme, reine d'Espagne, Contenant ses intrigues amoureuses avec le duc d'Alcudia et autres amans, et sa jalousie contre la duchesse d'Albe, etc., etc., À la cour d'Espagne Et se trouve à Paris chez tous les Libraires marchands de nouveautés, 1793.

Sous l'apparence d'un limonadier…
« La Dubois, de la comédie Françoise, malgré l'œil sévère de ses pères et mère, céda sa première fleur à un garçon limonadier. Il est vrai que ce garçon étoit le duc de Fronsac qui, en veste et en tablier, lui portoit tous les matins du chocolat. M. de Villeroi lui fit bientôt la cour, mais en marquis. »
Pierre Manuel
La Police dévoilée…*
* La Police de Paris dévoilée, par Pierre Manuel, L'un des Administrateurs de 1789, tome 2, Paris, Chez J. B. Garnery, an ii (1793). L'anecdote est reprise dans Le Monde Ilustré, du 27 avril 1861 (p. 267).

N. B. Ses débuts furent assez prometteurs, mais sa beauté valait plus que son talent. Ses aventures galantes furent innombrables. Gravitant dans l'entourage de la comtesse du Barry, Mademoiselle Dubois se fit protéger par quelques grands seigneurs et amassa une petite fortune.
Elle se retira en 1773 et mourut de la petite vérole en 1779.
La peur du poison
« Une femme trahie par son amant l'invita à déjeûner ; dès qu'il eut pris une tasse de chocolat, elle lui déclara que, désespérée de son infidélité, elle s'était décidée à s'empoisonner & à le faire périr avec elle, en empoisonnant ce qui leur avait été servi à déjeûner. L'inconstant fut saisi d'une telle frayeur, que peu s'en fallut qu'il ne mourut sur le champ. Quand la Dame délaissée eut bien joui de son trouble & de ses craintes, elle lui apprit qu'elle n'avait voulu que se divertir à ses dépens, & le renvoya charmé d'en être quitte pour la peur. »
Pierre-Jean-Baptiste Nougaret (1742-1823)
Les sottises et les folies parisiennes*
* Les sottises et les folies parisiennes ; aventures diverses, &c. Avec quelques pièces curieuses & fort rares : Le tout fidèlement recueilli par M. Nougaret, Londres, Chez la Veuve Duchesne, 1781.
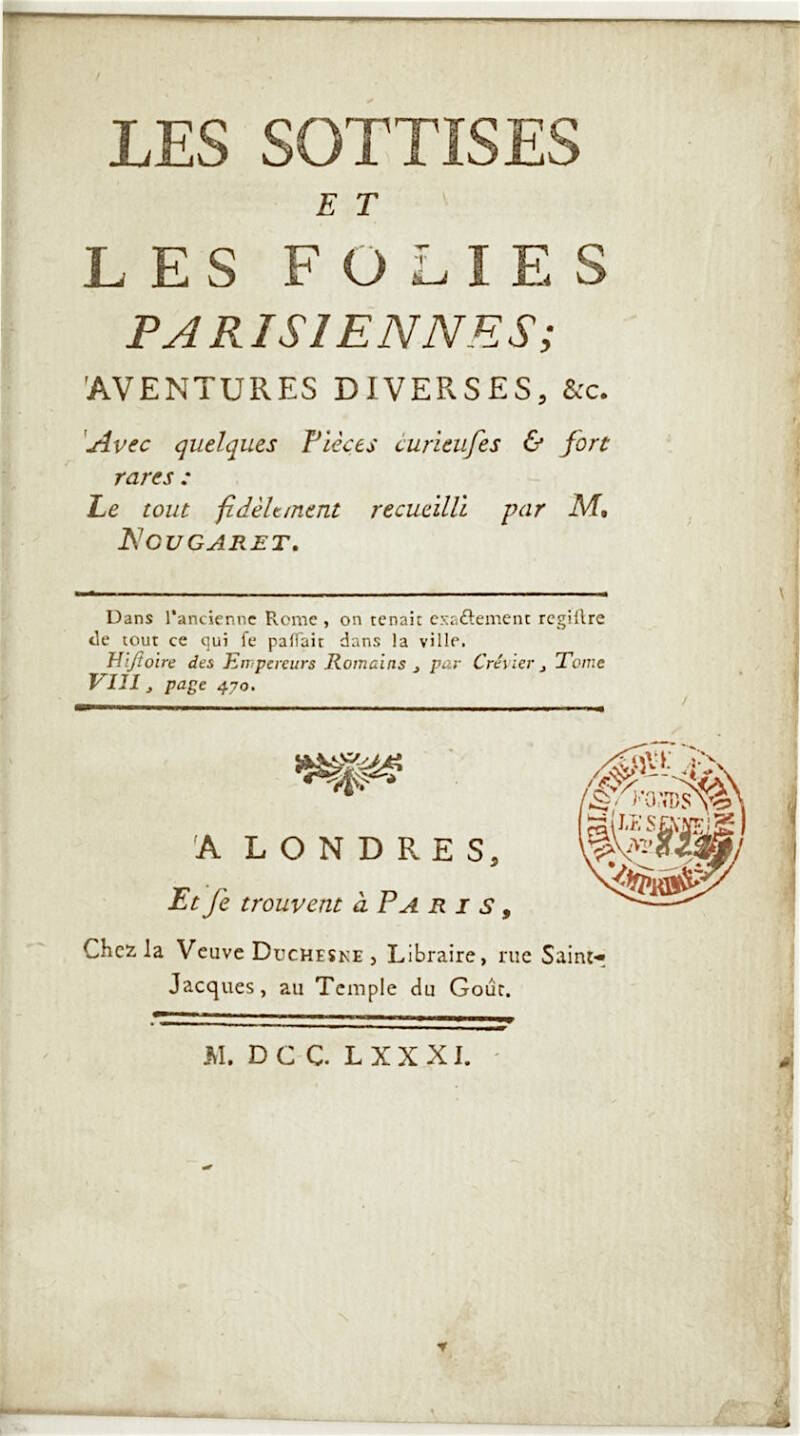
Or et chocolat
« […] Bonaventure de Malibran, un Français dès avant la Révolution au service de l'Espagne et qui s'était distingué dans les colonies d'Amérique. En janvier 1809, il était parti pour la délivrance de Ferdinand, un peu comme Don Quichotte à la conquête de Dulcinée du Toboso. Pensant bien que l'argent est encore l'arme la meilleure en pareille occurrence, il menait deux mules chargés de deux caisses remplies d'or, mais cachées, il le croyait du moins, sous des tablettes de chocolat. Il n'eut pas même la peine d'être pris par des gendarmes français : avant d'atteindre la frontière espagnole, arrêté deux fois par des paysans en armes, à Lérida et à Olinna, il fut remis en liberté, à cause des passeports très réguliers que lui avaient fournis, au nom de la junte suprême de Catalogne, Thomas de Véri et Théodore Reding, mais ses caisses n'eurent pas la même bonne fortune ; il ne les revit jamais. Il ne renouvela pas sa tentative généreuse, dont les archives de M. le duc de Saragosse* nous ont conservé les détails. »
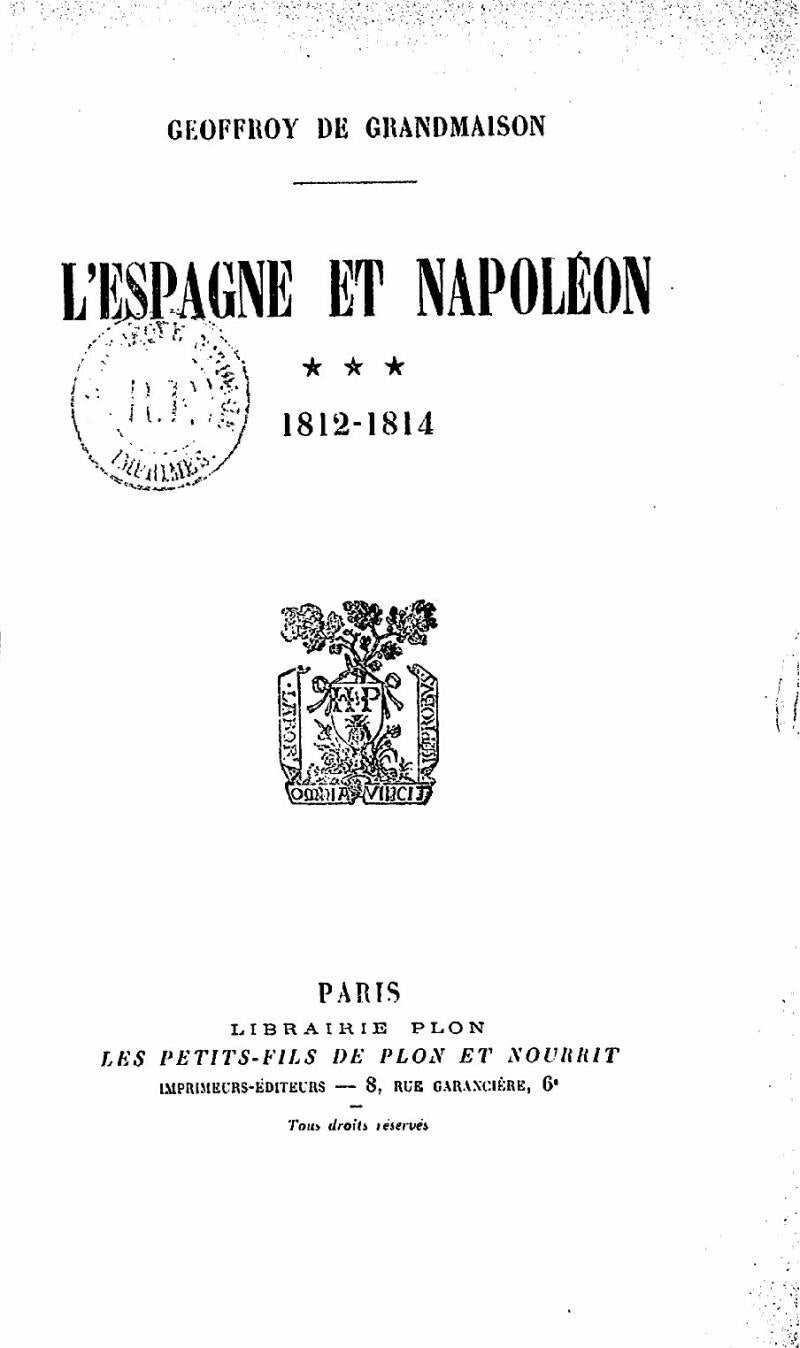
Geoffroy de Grandmaison
L'Espagne et Napoléon, 1812-1814**
* 1768-1842. Il fut receveur des finances à Grenade, intendant de la Sierra Morena, puis, administrateur de Puycerda.
** Paris, Librairie Plon, 1931.
« Parler chocolat »
« Lorsqu'il y avait menace de querelle, on parlait chocolat.
Ceci avait été inventé par MM. Pasquier et Chateaubriand, vers 1832, époque où la politique les mettait en guerre ouverte, et où ils se montraient fort exaspérés l'un contre l'autre.
Un soir, au moment où l'on s'y attendait le moins, ils se rencontrent à l'Abbaye.
Madame Récamier frissonne.
Heureusement ces fougueux adversaires ont une sympathie commune dans laquelle ils viennent se fondre : ils aiment passionnément tous deux le chocolat. Madame Récamier s'empresse d'établir une dissertation sur cette précieuse pâte alimentaire, et nos antagonistes se trouvent en parfait accord.
Depuis, on nomma chocolat tout sujet d'entretien qui devait inévitablement calmer les cerveaux.
La recette dut plus d'une fois être employée en 1848, autre époque de haine, où d'autres ennemis pouvaient à chaque minute se montrer dans le cercle. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte et M. de Lamartine, tous deux candidats présidentiels, vinrent le même jour, à un quart d'heure de distance, présenter leurs hommages à madame Récamier.
Cette sage et prudente habitude de parler chocolat pour mettre obstacle aux querelles politiques était, du reste, tout ce que l'Abbaye-aux-Bois avait conservé de ses beaux jours.
L'ennui et les ténèbres envahissaient de plus en plus le présent. »
Eugène de Mirecourt
Clémence Robert

Gravure d'après Sir William Quiller Orchardson, The Salon of Madame de Recamier, c. 1890.
L'agent Patou et le porteur de pamphlets
« La préfecture de police n'aimait pas le Constitutionnel, il ne faisait pas son éloge, il ne flagornait pas ses agents, il n'approuvait pas la conduite des chefs ni des subalternes ; il professait, en outre, les doctrines libérales, et n'était pas d'accord avec quelques employés de cette préfecture qui rédigeaient d'autres journaux, ou qui en étaient les actionnaires.
Enfin, le Constitutionnel était dangereux, séditieux ; il cherchait à égarer l'opinion publique, non-seulement par les articles qu'il offrait chaque jour à ses lecteurs, mais encore il corrompait la jeunesse. Il entretenait l'esprit révolutionnaire chez les hommes qui étaient imbus de ces principes ; il devait nécessairement faire colporter, distribuer des pamphlets séditieux dans les communes de la banlieue de Paris.
Il ne les envoyait pas par la poste, on les eût découverts ; mais les porteurs de ce journal en distribuaient à domicile. Telle est la pensée qui jaillit du cerveau des chefs de la police, ou qui leur fut suggérée par un de leurs amis.
Le Constitutionnel, et ceux qui le distribuaient dans la banlieue, furent donc mis en surveillance, principalement ceux qui le portaient dans les communes de la Villette, la Chapelle, Montmartre, les Batignolles, et autres.
L'agent Patou fut chargé de cette surveillance.
Il devait s'arranger de manière à ne pas perdre de vue le porteur, le prendre au moment où il sortait du bureau du journal, le suivre constamment, et le voir rentrer dans Paris après sa distribution, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à son domicile.

Honoré Daumier, Le Constitutionnel contemplant l'horizon politique, lithoraphie, 1849.
C'était dans le mois de février, le temps était froid, pluvieux ; n'importe, le danger était trop pressant pour s'arrêter à ces petites considérations ; d'ailleurs les chefs étaient auprès d'un bon feu, ne souffraient point de l'intempérie de la saison, tout le monde devait avoir chaud.
L'agent se mit donc en marche. Il vit sortir, à six heures du matin, un petit homme ayant en bandoulière une espèce d'énorme giberne, sur laquelle on lisait en lettres d'or : le Constitutionnel. Cette giberne ne renfermait pas de cartouches, mais quelque chose de bien plus dangereux !
L'agent s'aperçut que cet individu prenait la direction de la porte Saint-Denis, et il marcha sur ses traces. Il le vit distribuer ses journaux dans quelques maisons du faubourg, dans une pension de demoiselles. Il en fut étonné, comme si ces dames ne pouvaient pas être libérales.
Il passa la barrière, et voilà le porteur et son éclaireur en campagne.
Le distributeur ne s'arrêtait dans aucune maison, remettait promptement son journal à la porte, et continuait son chemin ; il entra seulement chez un épicier à La Chapelle, et y resta environ dix minutes. À cela près, il ne s'arrêta dans aucune des communes qu'il parcourut, et n'adressa la parole à personne. Il n'y avait rien de séditieux ni de criminel dans une telle conduite. Après avoir fini sa tournée champêtre, le porteur rentra dans Paris en suivant la même route. L'agent ne le perdit pas de vue.
Il descendit le faubourg Saint-Denis, suivit cette direction jusqu'ç la rue Thévenot ; alors, tournant à droite, il la parcourut jusqu'à la boutique d'un fabricant de chocolats et de liqueurs, il y entra.
L'agent s'aperçut que le porteur de journal était connu dans cette maison ; car on l'accueillait avec une sorte de bienveillance.
Venait-il chercher des pamphlets séditieux dans ce débit de consolation, ou donner quelques nouvelles aux conspirateurs dont ce magasin pouvait être le rendez-vous ? Voilà ce qu'il était très-important de savoir.
L'agent ne pouvait cependant pas s'introduire dans la maison du liquoriste ; on pouvait le remarquer, comment aurait-il suivi le lendemain le porteur du journal.
Il entra chez un marchand de vin, et attendit sa sortie. IL s'écoula environ une heure lorsque le porteur parut et prit le chemin de la rue Saint-Denis. Sa giberne, qui paraissait flasque et dégarnie lorsqu'il était entré chez le marchand de chocolat, avait repris de la rotondité ; que contenait-elle ? Des pamphlets, peut-être. Comment le découvrir ?
L'agent de la police fut donc obligé de s'en tenir aux soupçons, sans pouvoir les éclaircir. Il marchait toujours sur les traces du porteur de journal, qui se rendit rue Saint-Honoré, et monta dans une maison près la rue Tirechappe.
Son éclaireur resta quelque temps en observation ; il le vit sortir le tête nue, sans sa giberne, et il entra chez le marchand de vin du coin.
C'était donc là son domicile. Il le laissa se délasser de ses fatigues. L'agent, de son côté, se rendit à la préfecture, et rédigea un rapport contenant le détail de ce qu'il avait vu.
On l'engagea à continuer cette surveillance jusqu'à nouvel ordre, et il lui fut recommandé très-expressément de faire en sorte de découvrir ce que le porteur avait reçu chez le marchand de chocolat et de liqueurs de la rue Thévenot.
On était certain que c'était là un dépôt de pamphlets séditieux, et on y ferait plus tard une perquisition si les circonstances l'exigeaient, ou le salut de la France.
Le lendemain, avant le jour, l'agent était rue Saint-Honoré, près du domicile du porteur. Il le vit partir, ayant sa giberne sur le dos, et sous le bras un paquet enveloppé de papiers. Sans doute les pamphlets de la veille.
Il le suivit jusqu'au Constitutionnel ; il sortit ensuite avec ses journaux dans sa giberne.
Tout se passa comme la veille ; à La Chapelle, il entra chez l'épicier où il s'était arrêté le jour précédent, et il sortit peu de temps après, en ayant laissé dans cette maison le paquet enveloppé de papiers qu'il avait sous le bras.
L'agent, qui savait la route qu'il allait prendre, le laissa filer. Il était certain de le retrouver.
Il entra chez l'épicier, sous le prétexte de demander un petit verre, mais pour voir ce qu'était devenu le paquet de pamphlets.
Il l'aperçut sur le comptoir. Les écrits séditieux étaient tout bonnement du chocolat de santé que le porteur avait été chargé d'acheter rue Thévenot.
L'agent paya son petit verre, et se mit en route pour explorer son porteur de journal.
Il ne commit pas d'autres délits que celui du chocolat, et rentra dans Paris comme la veille, sans aller rue Thévenot.
L'agent fit un second rapport ; on avait peine à croire que ce fût réellement du chocolat. Pour plaire à messieurs les chefs de la police, il eût fallu que l'agent métamorphosât en pamphlets le cacao-caraque ; il n'en avait pas le talent, encore moins la volonté. Cette surveillance se continua pendant un mois sans offrir d'autres résultats. Le temps était affreux ; l'agent fit sentir, dans son rapport, l'inutilité de ses démarches, et il ne suivit plus le coureur du Constitutionnel.
On lui avait promis de lui tenir compte de quelques dépenses qu'il avait été obligé de faire en suivant, depuis le matin jusqu'à l'après-midi, le porteur du journal. On refusa de tenir la parole donnée. Il est vrai qu'il n'avait pas su deviner les intentions bénévoles de la préfecture, et trouver en défaut le porteur du Constitutionnel, ou les journalistes eux-mêmes. »
M. Froment
La Police dévoilée*
* La Police dévoilée, depuis la Restauration, et notamment sous messieurs Franchet et Delavau, par M. Froment, ex-chef de brigade du cabinet particulier du préfet, 2e édition, tome 2, Paris, Lemonnier Éditeur, 1829.
Le Chocolat du Castillan

« Il est ordinaire de voir à Rome une multitude innombrable de pauvres de tous les pays, auxquels on distribue la soupe à une certaine heure à la porte des monastères. Un Castillan nouvellement arrivé, et qui ignorait à quelle heure se faisait cette distribution, s'adressa à un pauvre ecclésiastique français pour le savoir. La vanité espagnole ne pouvait souffrir qu'il demandât simplement la maison où l'on donnait la soupe. Cette façon de parler lui paraissait trop ignoble. Après avoir cherché une manière de s'exprimer moins basse, il n'en trouva point de plus convenable que de demander au Français s'il avait pris son chocolat ? — Mon chocolat, répondit l'ecclésiastique, et comment voulez-vous que je le paie ? je vis d'aumônes, et j'attends qu'on distribue la soupe au couvent des Franciscains. — Vous n'y avez donc pas été, dit le Castillan ? — Non, reprit le Français ; mais voici l'heure où je vais m'y rendre. — Je vous prie de m'y conduire, dit le glorieux espagnol ; vous y verrez Dom Antonio, Perez de Valcabro de Ridin, de Montava, de Véga, etc., y donner à la postérité une marque de son humilité. — Et qui sont ces gens-là, demanda le Français ? — C'est moi, reprit le Castillan. — Si cela est, répliqua le Français, dites plutôt un exemple de bon appétit. »
Blismon Ana-Gramme
Gastronomania*
* Gastronomiana, Trésor des bons mots, plaisanteries, Aventures, Excentricités, etc., des Disciples de Comus, Paris, Delarue, 1857. L'auteur est, en fait, Simon Blocquel (1780-1863).
Le chocolat Mouilleron
Après la Révolution, l'abbé Mouilleron, recteur de Sainte-Marie, près de Pornic, dans le diocèse de Nantes, fut pressé, à l'instar des autres religieux, de prêter le serment imposé par la constitution civile du Clergé. S'y refusant, il quitta sa paroisse et chercha refuge chez un de ses frères, à Batz, d'où il était originaire, mais, poursuivi sans lasse par les révolutionnaires, il finit par s'embarquer au Croisic. Ayant mis à profit son séjour en Espagne pour apprendre l'art de fabriquer le chocolat, il alla s'établir à Londres et l'y pratiqua. Son entreprise rencontra un tel succès qu'il put venir en aide à plusieurs de ses confrères et que, du fait de sa renommée, la rue où se trouvait sa fabrique fut appelée « rue du Chocolat-Mouilleron ». De retour en France où avait été instauré le régime concordataire, l'abbé devint curé de Machecoul et mourut peu après, en 1803*.
* Le récit de cet épisode de la vie de l'abbé Mouilleron est donné par l'abbé Tresvaux (Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne à la fin du dix-huitième siècle, Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1845).
Le chocolat`
« Une belle dame fort à l'aise sans avoir une immense fortune, donnait un jour à dîner à une nombreuse compagnie. Comme elle faisait fort bien la cuisine, elle prépara elle-même quelques plats de prédilection, entre autres une crème au chocolat qui réussit à merveille.
On sert et l'on se met à table. La dame fit asseoir à côté d'elle, à la place d'honneur à sa droite, un Monsieur d'un certain âge. Il prenait beaucoup de tabac qui s'échappait malheureusement et souvent de son nez avec les sérosités de son cerveau. En un mot, les roupies pleuvaient autour de lui. La maîtresse de maison était en grande toilette. C'était alors la mode d'avoir les manches courtes et les bras nus, ce qui ne déplaisait pas à la dame, parce qu'elle les avait fort beaux. On mange, on boit, on bavarde et le repas s'avance fort gaiment. Cependant la pose des plats était dirigée par la dame du logis et passaient sur la table à côté d'elle, afin qu'elle pût donner ses ordres tout bas à la fille de service. On apporte enfin la fameuse crème au chocolat ; mais le plat était un peu trop rempli, aussi la dame en jetant les yeux sur elle vit son bras tout taché, ce qui la fâcha contre la maladroite fille qui avait sans contredit versé de la crème en passant le plat. Voulant faire aussitôt disparaître cet emplâtre, elle saisit un moment de distraction des convives et suça lestement cette tache. — Miséricorde ! quelle grimace affreuse ne fit-elle pas quand au lieu de chocolat elle sentit que c'était une bonne et véritable roupie de son voisin qu'elle avait avalée. Elle fut obligée de se sauver promptement de table pour se remettre un moment de sa mésaventure qui lui valut un demi-grain d'émétique. Elle m'a raconté souvent elle-même son burlesque accident, protestant que de sa vie elle ne serait plus lécheuse. »
Comte Bony de La Vergne
Anecdotes, bons mots, saillies, balourdises, excentricités, 2e édition, Metz, 1843.
Le cheval en chocolat
« La semaine a compté plusieurs réunions de belle gastronomie, — dit le Sport. Le dîner, qui a eu lieu aux Frères-Provençaux, et dont M. le comte Eugène Lehon était l'amphitryon, a eu quelque éclat. Les convives appartiennent tous à la société de chasse de La Ferté-Vidame. De ce nombre, MM. le prince Poniatowski, le comte Daudun, le vicomte Mirabeau, le comte de Prado, M. Visconti, M. de Saint-Martin, etc. Le motif de cette réunion était de célébrer la victoire de Gouvieux sur ke champ de course du bois de Boulogne.
M. le comte Eugène de Lehon avait voulu, comme un hors-d'œuvre gastronomique, que la représentation du cheval parût à table reproduite en chocolat, de demi-grandeur naturelle. Le cheval fut exécuté en pur Manille, mais par malheur, une maladresse domestique brisa ce magnifique travail, chef-d'œuvre du Carême des Frères-Provençaux ; au moment de le servir, le cheval fut broken down, et comme il aurait fallu le servir en morceaux, on se contenta de raconter sa fin malheureuse et de passer outre. »
Le Gourmet, n° 14, 23 mai 1858*
* Journal des intérêts gastronomiques. Rédacteur en chef : Charles Monselet.

Les Frères Provençaux, vers 1846, planche extraite du London News (1846).
La manière d'offrir double le prix d'un bienfait
« Pour faire le bien, il suffit souvent d'obéir à un premier mouvement de générosité, à un entraînement momentané de l'âme ; mais savoir faire le bien est le propre d'un cœur délicat et généreux. — Un présent offert avec brusquerie, sans ménagements pour l'amour-propre, peut blesser celui à qui il est destiné au lieu de lui plaire et de mériter sa reconnaissance. Il est donc nécessaire de s'accoutumer à obliger avec discernement et à réserver pour cette sorte d'occasion tout le tact dont on est doué.
Quelques exemples de délicatesse ingénieuse feront comprendre notre pensée.
Un des plus grands virtuoses des temps modernes, le célèbre Viatti, aimait la campagne avec passion ; l'aspect de la végétation, de la verdure et des fleurs le jetait dans les transports d'une joie indicible. Dans les dernières années de sa vie, le violoniste brûlait de faire l'acquisition d'une délicieuse ville, à une trentaine de lieues de Paris. Finir ses jours dans ce lieu charmant était son rêve le plus doux, le plus caressé ; mais la réalisation de ce rêve était impossible.
On demandait cinquante mille francs de la villa en question, et Viatti avait si mal administré ses affaires, qu'après un long et fructueux exercice de sa profession, il se trouvait dans l'impossibilité de donner cette somme.
Napoléon aimait beaucoup le virtuose et l'accueillit avec plaisir. Il avait entendu parler de son goût passionné pour la vie champêtre, il connaissait ses projets et les difficultés de sa position. C'est par une plaisanterie assez originale que l'Empereur le mit en possession du joli domaine vers lequel s'élançait sa poétique imagination.
C'était le premier jour de l'année 1811. Viatti était venu présenter ses compliments à Napoléon. L'Empereur l'accueillit avec une bonté toute particulière, s'entretint longtemps avec lui ; puis au moment où l'artiste se disposait à s'éloigner, il ajouta tout à coup :
— À propos, monsieur Viatti, j'ai vu l'autre jour votre nièce, elle est charmante, et je veux lui faire un cadeau de nouvelle année. Voici du chocolat délicieux ; veuillez prier mademoiselle votre nièce de l'accepter de ma part.
En disant ces mots, l'Empereur remit à Viatti un petit paquet qui avait la forme d'une bille de chocolat excessivement mince.
Arrivé chez lui, le violoniste dit en souriant à sa nièce :
— Ma bonne amie, voici le cadeau que te fait l'Empereur : c'est une bille de chocolat qu'il m'a chargé de te remettre. Tu sais qu'il est parfois bizarre, original…
Mais la jeune fille s'est hâtée de briser l'enveloppe, d'ouvrir le paquet, et tout commentaire de l'étrangeté du cadeau impérial est devenu inutile. Jugez de l'étonnement et de l'émotion de l'oncle et de la nièce ; la bille de chocolat, c'étaient… cinquante billets de banque soigneusement roulés. Juste la somme nécessaire à l'acquisition du joli domaine que Viatti brûlait de posséder. »
Comtesse Drohojowska
De la politesse et du bon ton ou Devoirs d'une femme chrétienne dans le monde,
Paris, Victor Sablit Libraire-Éditeur, 1860.
La curieuse posologie du docteur Koreff
« […] le docteur Koreff, un autre Krespel, un autre Kreisler, tout ce qu'on pourra imaginer de plus fantastique au monde, était attablé devant un grand verre de cristal rempli de citronnelle. Une brioche, qu'il trempait de temps en temps dans la liqueur, formait la portion la plus grossière de ce repas pythagorique. Sans doute, le nom de cet israélite allemand était venu jusqu'à mes oreilles, mais c'était tout. Je ne savais donc encore ni l'homme ni son système de médication, tout hérissé de bizarreries et de hardiesses. On pense, bien que je ne laissai pas échapper l'occasion, qui m'était offerte par le hasard, d'étudier un peu, de visu, ce nouvel hôte de notre Paris.
[…]
Henri Heine et le docteur Heller, qui le connaissaient puisqu'ils étaient de la même origine que lui, le firent prier par un garçon de café de venir un moment à notre table, ce qu'il fit sans la plus légère difficulté, en personnage bienveillant qu'il ne cessait pas d'être, même avec les hommes. Il vint donc et s'assit et, en un français un peu empâté, il se mit à faire le procès du chocolat et du café au lait, deux genres de nourriture qui ne pouvaient que nuire au développement de la famille humaine.
— Qu'on les traduise tous les deux en cour d'assises comme subversifs des meilleures constitutions ! s'écria Henri Heine en achevant une tartine au beurre.
Mais Koreff dédaigna l'épigramme et ajouta d'un ton doctoral :
— Pour bien déjeuner, selon le vœu de la nature, prends une infusion de violettes ou de réséda. Telle sera la médecine de l'avenir.
— Eh bien, riposta le railleur, si les dieux m'envoient un fils, j'en ferai un herboriste plutôt qu'un chirurgien. »
Philibert Audebrand
Souvenirs d'un journaliste, dans le Musée Universel, 1877
Souvenir du café Foy…
« Le maître du café était l'homme du monde le plus aimable. Il nous regardait comme ses enfans et riait de nos folies. Celui-là, au moins, n'a pas vu la ruine de la maison, puisque la mort le prit la veille des échéances — des déchéances, hélas !
[…]
En 1802, un chevalier de Saint-Louis était venu déjeuner pendant tout un hiver d'une tasse de chocolat qu'il payait régulièrement ; mais, l'hiver passé, il ne paya plus ; du moins il payait par un salut et par un sourire. C'était un homme si bien né, ses airs de ci-devant tournaient si bien la tête à la maîtresse de la maison, qu'on résolut de ne jamais lui dire un mot ; il déjeuna ainsi jusqu'en 1816, au temps du milliard des émigrés. Un matin, sans que rien parût changé en lui, il se présenta au comptoir, offrit une prise, secoua son jabot et dit ce seul mot : “ Combien ? — Combien ? monsieur le chevalier, nous n'avons pas compté. — Eh bien ! rien n'est plus simple : quinze années à trois cent soixante cinq jours, chaque jour à 1 franc, total...
Il paya ; après quoi il se tourna vers les garçons : “ Il faut bien, dit-il, que ces coquins-là aient leur part du milliard des émigrés. ” Et il fit voler vers eux un billet de 1,000 francs. »
Arsène Houssaye
Les confessions - Souvenirs d'un demi-siècle, 1830-1880, Paris, E. Dentu, 1891.
La macreuse au chocolat
Dans les Indiscrétions Parisiennes (2e tableau, III), le commentaire suivant est placé dans la bouche du Baron Brisse : « La Halle baisse, le poisson est moins beau de qualité, les huîtres d'Espagne ne sont pas encore arrivées… — Le bœuf et le veau vont doucement. Le cheval s'emporte. — J'ai trouvé un plat nouveau, — La macreuse au chocolat. — Dans un couvent, que je ne veux pas nommer, on servait aux jeunes pensionnaires des macreuses décorées du nom pompeux de canards sauvages. — Une jeune pensionnaire, par espièglerie, s'avisa de jeter une tablette de chocolat dans le ragout. — L'huile du chocolat s'unit à l'huile de la macreuse et produisit un coulis délicieux. — Ce mets est digne des meilleures tables.
On sait que ce sont les couvents qui ont le plus développé l'art culinaire, surtout dans la partie des entremets sucrés. »
Lemercier de Neuville
Paris Pantin*
* Deuxième des série des Pupazzi, Paris, Librairie Internationale, 1868. Édition illustrée de trente dessins.
Les tablettes de M. Gambetta
« Qui oubliera jamais cette première fête de Christkindel dans cette salle de café-concert, à demi pleine, froide, sombre, par une après-midi grise, avec des tas de petites tètes blondes ou brunes, vaguement aperçues entre les colonnes du music-hall ? On était alors en pleine lutte politique et au lendemain même des blessures reçues. La plaie saignait encore. On ne pouvait guère regarder qu'à travers des larmes les sourires des petits exilés. Et qu'ils étaient heureux, ceux-là, étonnés, ouvrant de grands yeux aux pantins et aux poupées !
On en attendait quelques centaines ; il en accourut plus d'un millier.
Alors, un moment vint où, dans la salle de l'Alcazar il y avait encore des enfants qui attendaient leurs joujoux et où, sur l'estrade, il n'y avait plus rien à leur distribuer. Ni jouets, ni bonbons. Les paniers étaient vides. Fallait-il donc laisser repartir, déçus, avec de gros soupirs, ces demi-orphelins — orphelins de la patrie — à qui on avait promis un beau Christkindel ? Certes, non ! On fit, là -haut, sur la petite scène une collecte entre membres du comité et dames patronnesses ; on courut en hâte chez les épiciers du voisinage ; on rapporta par brassées tout ce qu'on put trouver — des poupées d'un sou, des oranges de deux sous, qu'importe ! et on revint, les mains chargées, les poches pleines, vers ces petits qui attendaient fiévreusement avec leurs grands yeux avides.
Et le défilé continuait.
Les fillettes et les gamins montaient, tout émus, les marches de l'estrade. Même après ce pillage des épiceries d'à côté, on n'allait bientôt plus ne rien avoir à leur donner. Il fallut briser par fragments les tablettes de chocolat pour que les derniers emportassent au moins quelque chose. C'est M. Gambetta qui les cassait en deux ces tablettes et les passait à Mme Floquet, qui les distribuait à ces petites mains tendues.
Au dehors, les habitants du faubourg Poissonnière, assez surpris, se demandaient pourquoi tout ce monde et ce que venait faire à l'Alcazar cette troupe d'enfants. On se mettait aux fenêtres pour voir, assis sur les trottoirs et ouvrant nerveusement leurs paniers, leurs boîtes de soldats, regardant leurs joujoux ou défaisant les paquets où il y avait des bas de laines, des casquettes ou des hardes, ces petits qui sortaient de là tout stupéfaits, comme si ce Christkindel à Paris était un rêve.
M. Seinguerlet, les larmes aux yeux, sortit de là, le cœur serré, et il racontait, à quelques pas de l'Alcazar, cette scène poignante à M. Spuller qui, ému lui-même de l'émotion qui étreignait l'historien de Strasbourg, écrivait le soir même, sur cette première fête de l'Arbre de Noël, un de ses articles les plus éloquents et les mieux venus. »
Jules Claretie
La vie à Paris 1881, 27 décembre 1881, La vie à Paris, année 2, Paris, Victor Havard, 1881.
Le chocolat au service d'un voleur
« Une petite dame, aimant fort les bonbons, avait reçu, de l'un de ses adorateurs, un sac de caramels au chocolat, auquel était jointe une lettre annonçant un rendez-vous pour le soir, à sept heures.
La petite dame, pour ne point oublier l'heure susdite, aligna sept tablettes sur sa cheminée, et sortit, au moment voulu, rappelée au rendez-vous par ce genre de mnémotechnie.
Le soir, en rentrant, elle constata que son coffre-fort avait été entièrement vidé de ses valeurs, quoique aucune trace d'effraction n'apparût sur la serrure.
Le magistrat enquêteur, en examinant de près le meuble, reconnut l'emploi de fausses-clefs, et, hasard miraculeux, constata que l'empreinte de la serrure avait été prise au moyen d'une matière sucrée sentant le chocolat.
La petite dame, présente à l'opération, remarqua alors la disparition de ses sept tablettes de caramel, inoffensifs bonbons transformés, pour la circonstance, en agents malléables et appliqués, en manière d'empreinte, sur la serrure. »
Pierre Delcourt
Le vice à Paris, Paris, A. Piaget, 1888.
Le président Félix Faure à Saint-Pétersbourg en 1897
« Durant le voyage du Président en Russie un grand nombre de bibelots ont été fabriqués à l'effet d'en perpétuer le souvenir. En France, pour la. même occasion, les collections s'augmentaient et représentaient M. Félix-Faure sur tous les objets qui étaient créés.
Si en Russie le camelot est inconnu, en revanche les maisons de commerce et les bazars étaient encombrés de bibelots […].
[…]
Les boîtes à bonbons sont nombreuses. Elles affectent toutes les formes. Sur les couvercles tantôt le Président y est représenté, tantôt c'est une scène militaire, tantôt ce sont des marins qui fraternisent, tantôt ce sont des drapeaux entrelacés. Les côtés des boîtes sont coloriés en bleu, blanc et rouge.
La confiserie pour, vendre ses produits, les a baptisés de noms français. Il y a le dessert Félix-Faure, le chocolat Félix-Faure, le bonbon Félix-Faure.
La Maison Blickhan et Robinson, de Saint-Petersbourg, a innové des enveloppes à bonbons où est représenté le Président.
Henri Daragon
Le président Félix-Faure en Russie, Paris, Henri Jouve, 1897.
« Les araignées chimériques de l’astronome Lalande »
« Déjà, au commencement de ce siècle, d’habiles confiseurs donnaient à leurs bonbons l’aspect d’un jouet, d’une fleur ou d’un insecte, qui n’était pas toujours appétissant.
Un grand savant, doublé d’un aimable fumiste, l’astronome Lalande, avait une prédilection gastronomique aussi répugnante que bizarre pour les … araignées*. Il en avait toujours une douzaine de mignonnes et de grassouillettes dans sa bonbonnière ; et c’était, dans son entourage, des cris d’horreur, lorsque le vieux savant prenait, délicatement, un de ces hideux insectes pour le croquer avec volupté.
Un jour, le célèbre astronome était en visite chez son amie, la comtesse de Perthuis. Une araignée superbe apparaît sur la table du salon.
— Voilà votre affaire ; regardez comme elle est belle, mon cher ; mais dépêchez-vous donc!…
— Je n’en ferai rien, madame ; hier, en me couchant, je me sentais en appétit et j’ai mangé vingt-trois araignées qui m’ont valu une indigestion.
— Une indigestion d’araignées, c’est original. Allons, une de plus ou de moins, laissez-vous tenter.
— En fin de compte, pourquoi mangerais-je cette pauvre bête ? elle ne m’a rien fait que je sache !
Et le joyeux astronome confia, sous le sceau du secret, à la comtesse de Perthuis que les fameuses araignées de sa bonbonnière étaient en chocolat de première qualité. Un habile confiseur de ses amis les confectionnait pour son plaisir gourmand et pour la stupéfaction des badauds. »
Fulbert Dumonteil
La France Gourmande
* « Michelet a récemment rappelé, nous dit Louis Niclardot, que « nous devons à Lalande de savoir « que la chenille a le goût de l'amande et l'araignée celui de la noisette, et qu'il s'habitua à se régaler d'araignées, à cause de la délicatesse inconnue qu'il leur trouvait. Lalande se faisait un jeu de ces essais de bouche : le fait est de notoriété publique. » (Histoire de la table, Curiosités gstronomiques de tous les temps et de tous les pays, Paris, E. Dentu, 1868.)

Le Sourire, 1er janvier 1914
Alimentation en temps de guerre
« César Franck était d'une grande bonté. Mon ami Henri Duparc qui, avant de devenir le maître qu'il est, fut l'élève préféré de l'auteur des Béatitudes, me contait qu'en 1870 il le rencontra dans une rue de Paris, tenant un seau à charbon de chaque main.
— Vous arrivez de loin ? interrogea Duparc.
— Mais oui. Il faut compter cinq kilomètres, de chez mon marchand de combustible jusqu'à chez moi. Je réalise une économie en m'astreignant à cette corvée : ce fournisseur est le moins cher que je connaisse.
— Comment se porte-t-on chez vous ?
— Les temps sont durs ; nous avons recueilli quatre parents plus pauvres que nous, ce qui fait neuf personnes à entretenir.
— Neuf personnes ! Et comment vous nourrissez-vous ?
— Eh bien ! voilà : nous possédons un vaste chaudron ; nous l'emplissons d'eau que nous faisons bouillir ; et, pour donner un peu de goût à cette eau, nous y faisons fondre quatre ou cinq tablettes de chocolat. Nous trempons notre pain dedans, tant et plus, car nous n'avons que du pain à notre disposition... du pain, et ce chocolat. Vous voyez que nous prenons du chocolat, beaucoup de chocolat...
Et César Franck ajouta, en s'en allant, après avoir repris, sur le bord du trottoir, ses deux seaux remplis de charbon :
...beaucoup de chocolat. Trop de chocolat. »
Francis Jammes
Pensée des jardins, Œuvres de Francis Jammes, IV, Paris, Mercure de France, 1913.

Copyright Annie Perrier-Robert. © Tous droits réservés.
Ajouter un commentaire
Commentaires